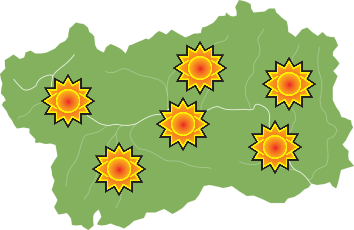CHAMIN
Situé à flanc de montagne, sur un balcon naturel au cœur d’épaisses forêts, Chamin est bien visible depuis la route régionale de Valgrisenche, avant d’arriver à Planaval : l’on y parvient en suivant la route communale inaugurée en 1965qui monte depuis Chamençon.
Chamin n’est habité que pendant l’été, par les gens qui aiment la tranquillité : ce ne fut qu’au cours de la deuxième guerre mondiale que certaines familles s’y installèrent en hiver aussi. Ce village est caractérisé par sa position centrale par rapport aux champs en terrasses, d’un côté, et aux prés, de l’autre : deux zones séparées par le sentier que suivaient autrefois les troupeaux et qui monte aux alpages de Pileo et de Borègne.
Un peu à l’écart des maisons, l’on trouve la chapelle rectangulaire à chevet droit : son beau clocher est doté d’un escalier de pierre en colimaçon, adossé à son côté droit.
Sa façade présente une ouverture réniforme au-dessus de la niche qui accueillait autrefois une très précieuse statue en albâtre de la Vierge à l’Enfant, sculptée par Stefano Mossettaz entre 1421 et 1422 pour la chapelle funéraire de l’évêque Oger Moriset, dans la cathédrale d’Aoste. Achetée par le curé d’Arvier en 1907, cette statue est aujourd’hui exposée au musée du trésor de l’église paroissiale. L’ancienne chapelle, reconstruite en 1662, fit l’objet d’importants travaux de rénovation pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. En 1871, la chapelle et son clocher furent bénis par l’abbé Ambroise Roux, jeune prêtre originaire du village qui écrivit, en 1910, l’intéressante monographie « La paroisse d’Arvier – Son église, ses chapelles, ses curés – par un enfant du pays ». La chapelle de Chamin est aujourd’hui en ruine à cause, notamment, du glissement constant du terrain où elle est bâtie : elle a plusieurs fois été la cible de cambrioleurs et est désormais complètement dépouillée.
Ce village abritait autrefois le siège de « La Confrérie de Saint-Pantaléon », laquelle disposait d’ustensiles de cuisine, ainsi que d’un service de table et de couverts qu’elle mettait à la disposition des différentes familles qui s’occupaient, à tour de rôle, de l’organisation de la fête patronale : à cette occasion, l’on achetait une fontine et du pain, tandis que le vin, fait par les membres de la confrérie avec les raisins récoltés en automne et mis en tonneau, était offert aux invités, au prêtre et aux chantres.
Après la messe, tout le monde se rendait au siège de la confrérie, où des tables et des bancs avaient été installés : dans l’après-midi, l’on dansait sur la terrasse toute proche.
Sources :
Ambroise Roux, La Paroisse d’Arvier, Imprimerie Catholique, Aoste 1910.
Pro Loco di Arvier, Le Conte d’eun cou, Imprimerie valdôtaine, Aoste 1995.
AA.VV., Arvier, Una comunità nella Storia, Musumeci editore, Quart 2004.
AA.VV., Planaval, Histoire, mémoire et traditions d’une petite communauté, LeChâteau, Aoste 2009.
AA.VV., Baise-Pierre, Entre histoire et souvenir, Tipografia Marcoz, Morgex 2011.