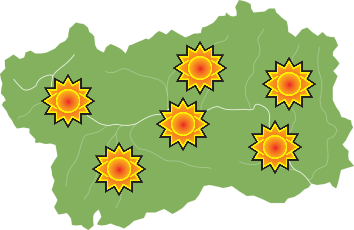CHEZ-LES-GARIN
C’est à Chez-les-Garin, petit hameau situé en amont de Leverogne et au-dessous du promontoire de Rochefort, que naquit en 1872 Maurice Garin, l’un des personnages les plus connus d’Arvier.
Maurice émigra en France, pour y travailler comme ramoneur et, à cause de sa petite taille (1,61 m pour 60 kg), il fut surnommé « le petit ramoneur ». Grâce à sa détermination et à son amour du cyclisme, il remporta la première édition du Tour de France, entrant ainsi dans l’histoire.
Installé à Lens, ce célèbre cycliste ne revint jamais à Chez-les-Garin, qui, après quelques années de quasi-abandon, a recommencé à vivre grâce aux familles qui ont rénové ses anciennes maisons pour s’y installer.
Le hameau dispose aussi d’un four à pain, restauré entre 2011 et 2012 : c’est le plus grand de toute la commune, avec son diamètre interne de trois mètres, et il peut contenir jusqu’à 100 pains.
Chaque année au mois de mai, la procession qui monte au sanctuaire de Rochefort traverse le village.
Sources :
Ambroise Roux, La Paroisse d’Arvier, Imprimerie Catholique, Aoste 1910.
Pro Loco di Arvier, Le Conte d’eun cou, Imprimerie valdôtaine, Aoste 1995.
AA.VV., Arvier, Una comunità nella Storia, Musumeci editore, Quart 2004.
AA.VV., Planaval, Histoire, mémoire et traditions d’une petite communauté, LeChâteau, Aoste 2009.
AA.VV., Baise-Pierre, Entre histoire et souvenir, Tipografia Marcoz, Morgex 2011.
CHEZ-LES-FORNIER E CHEZ-LES-MOGET
Les deux agglomérations distinctes de Chez-les-Fournier (en patois Tchu Fourgnì) et de Chez-les-Moget (Tchu Modzè) se trouvent près du chef-lieu, le long de la route qui relie ce dernier aux hameaux hauts du Verney, du Petit-Haury et du Grand-Haury et qui passe à côté du village de La Crête.
Les toponymes Chez-les-Fournier et Chez-les-Moget, tout comme plusieurs autres du territoire communal (Chez-les-Garin, Chez-les-Roset, Chez-les-Gex, Chez-les-Sage/Chez-les-Moulins, Chez-les-Vection et Chez-les-Thomasset) sont issus des anthroponymes, c’est-à-dire des noms des familles qui habitaient là, à l’origine.
En 1875, cinquante-huit personnes habitaient au hameau de Chez-les-Fournier, alors qu’une seule famille de cinq personnes vivait à Chez-les-Moget. De nos jours, les deux hameaux sont très peuplés, notamment du fait de la construction de nouvelles habitations.

Sources :
Ambroise Roux, La Paroisse d’Arvier, Imprimerie Catholique, Aoste 1910.
Pro Loco di Arvier, Le Conte d’eun cou, Imprimerie valdôtaine, Aoste 1995.
AA.VV., Arvier, Una comunità nella Storia, Musumeci editore, Quart 2004.
AA.VV., Planaval, Histoire, mémoire et traditions d’une petite communauté, LeChâteau, Aoste 2009.
AA.VV., Baise-Pierre, Entre histoire et souvenir, Tipografia Marcoz, Morgex 2011.
MECOSSE
Situé dans une cuvette ensoleillée, à l’abri des vents, Mecosse est le premier hameau d’Arvier que l’on rencontre en venant d’Aoste : il est situé à la limite de la commune de Villeneuve, à 707 m d’altitude, ce qui en fait le hameau le plus bas de la commune. Pour le rejoindre, depuis la route nationale 26, il faut traverser le saut-de-mouton au-dessus de la voie ferrée Aoste-Pré-Saint-Didier.
En face, sur l’autre rive de la Doire, les anciens vignobles de Porchère sont aujourd’hui incultes : c’est là qu’en 1830, grâce aux donations de neuf propriétaires, fut bâtie une petite chapelle dédiée à la Sainte Croix.
Le 3 mai, jour de la fête patronale, en revenant de ce que l’on appelle la « procession des vignes », l’on offrait aux fidèles du pain et du fromage, avec l’excellent vin du gros tonneau conservé dans la cave, au-dessous de la chapelle : à l’époque des vendanges, chaque propriétaire de vignoble offrait en effet un panier de ses meilleurs raisins et les chefs de famille, tour à tour, assuraient la production d’un bon vin pour la fête patronale.
Sources :
Ambroise Roux, La Paroisse d’Arvier, Imprimerie Catholique, Aoste 1910.
Pro Loco di Arvier, Le Conte d’eun cou, Imprimerie valdôtaine, Aoste 1995.
AA.VV., Arvier, Una comunità nella Storia, Musumeci editore, Quart 2004.
AA.VV., Planaval, Histoire, mémoire et traditions d’une petite communauté, LeChâteau, Aoste 2009.
AA.VV., Baise-Pierre, Entre histoire et souvenir, Tipografia Marcoz, Morgex 2011.
LA CRÊTE
Non loin du chef-lieu, après les hameaux de Chez-les-Fournier et de Chez-les-Moget, l’on trouve le hameau de La Crête.
Autrefois, son centre historique, dont les maisons sont très proches les unes des autres, fut habité par des familles de notables (comme les Martinet, au XVIIe siècle) et, d’après ce que l’on dit, accueillit aussi un tribunal.
C’est à La Crête et dans le bourg de Leverogne que se trouvent les éléments architecturaux les plus précieux de la commune.
L’on peut notamment admirer, à La Crête, l’ancienne maison où se trouvait l’étude d’un notaire, avec sa fenêtre en pierre, où sont sculptés la croix et le symbole de la Maison de Savoie : sur tout le territoire de la commune, il s’en trouve seulement quatre autres de la même facture.
En amont du village, le long du canal d’irrigation « Eaux Sourdes » au lieu-dit Les Bauses, l’on découvre les vestiges d’une scierie hydraulique. Joseph Gadin la construisit en 1899, après avoir passé un accord avec l’administration communale : celle-ci l’autorisa à la bâtir, mais lui, en échange, dut préparer gratuitement le bois nécessaire à l’entretien de trois ponts communaux.
L’acte de fondation remonte à 1630, en pleine épidémie de peste, si bien qu’il fut signé en rase campagne et que la cérémonie fut assortie d’une prière au Seigneur pour qu’il arrête ce fléau qui, en six mois, provoqua la mort de 365 personnes.
Selon la légende, la population d’Arvier était, en revanche, sortie indemne de l’épidémie précédente, en 1585, grâce à l’intercession des saints Roch et Sébastien.
Actuellement, le village est partiellement habité par des familles qui ont rénové certaines maisons, mais il reste en grande partie à l’abandon.
Sources :
Ambroise Roux, La Paroisse d’Arvier, Imprimerie Catholique, Aoste 1910.
Pro Loco di Arvier, Le Conte d’eun cou, Imprimerie valdôtaine, Aoste 1995.
AA.VV., Arvier, Una comunità nella Storia, Musumeci editore, Quart 2004.
AA.VV., Planaval, Histoire, mémoire et traditions d’une petite communauté, LeChâteau, Aoste 2009.
AA.VV., Baise-Pierre, Entre histoire et souvenir, Tipografia Marcoz, Morgex 2011.
GRAND-HAURY
Si l’on exclut La Cascina, cet ancien édifice agricole dépendant du château de Montmayeur, la chapelle dédiée à Sainte-Marie-Madeleine est le premier bâtiment que l’on rencontre en arrivant au Grand-Haury. Elle est citée pour la première fois dans un acte notarié de 1362, mais l’édifice actuel semble remonter à 1473.
Une légende transmise par les vieux du village raconte qu’il y a plusieurs siècles, la chapelle abritait deux anciennes statues représentant saint Hilaire et sainte Barbe. Elles étaient en si mauvais état que les habitants du village les avaient déplacées à l’extérieur de l’édifice, sans se soucier de leur sort, dans l’intention de les remplacer par de nouvelles statues. Des enfants les prirent pour jouer et les traînèrent dans la boue avec des cordes. Immédiatement, il commença à pleuvoir, très fort, comme jamais auparavant : les gens entendirent aussi des bruits sourds inexplicables. Quand les eaux du torrent débordèrent, ils s’aperçurent de leur imprudence : ils prirent les statues et les lavèrent pour les remettre à leur place. Il plut encore jusqu’au lever du soleil, puis la pluie cessa soudainement et les habitants décidèrent alors d’aller voir ce qui avait pu provoquer les bruits sourds qu’ils avaient entendus. En amont du village, dans la forêt, ils virent, sur la paroi rocheuse, de grosses fissures qui n’existaient pas auparavant et que l’on peut encore voir aujourd’hui : le village avait risqué d’être emporté par des éboulements.
Le Grand-Haury est caractérisé par sa position le long d’un axe, qui va de lachapelle au moulin, passant à côté du four récemment rénové, dont la salle est aussi utilisée pour des moments conviviaux.
Les maisons du hameau ont presque toutes été rénovées avec soin et bon goût. Certaines d’entre elles accueillent désormais des activités touristiques, qui attirent des touristes où, en été, s’installent aussi de nombreuses familles de la commune.
Avant d’arriver au village, au-dessous de la route communale, l’on trouve la scierie à eau de la famille Pontal, alors qu’aux alentours du hameau, sur un éperon rocheux, l’on peut admirer l’ancien château de Montmayeur, qui ressemble à une enceinte fortifiée plutôt qu’à un château résidentiel.
Ce dernier fut fondé en 1271, lorsque Philippe de Savoie donna à Anselme et Aymon d’Avise la permission de le construire. Cette date a récemment été confirmée par les résultats des relevés dendrométriques effectués sur des échantillons de bois prélevés dans le donjon et sur les remparts.
La tour présente un couronnement crénelé en queue d’aronde et mesure environ douze mètres de haut, avec des murs dont l’épaisseur dépasse les deux mètres : sa porte d’entrée se trouve au niveau du premier étage.
Le château qui, par sa position géographique, est l’un des plus charmants de la Vallée d’Aoste, fut cédé aux Savoie au XIVe siècle, puis inféodé aux Avise, avant d’être progressivement abandonné. Il appartient aujourd’hui à un particulier.
Des gens s’aventurent parfois dans ses environs, pour chercher l’ancien trésor qui, selon la légende, fut caché par le seigneur de Montmayeur.
Sources :
Ambroise Roux, La Paroisse d’Arvier, Imprimerie Catholique, Aoste 1910.
Pro Loco di Arvier, Le Conte d’eun cou, Imprimerie valdôtaine, Aoste 1995.
AA.VV., Arvier, Una comunità nella Storia, Musumeci editore, Quart 2004.
AA.VV., Planaval, Histoire, mémoire et traditions d’une petite communauté, LeChâteau, Aoste 2009.
AA.VV., Baise-Pierre, Entre histoire et souvenir, Tipografia Marcoz, Morgex 2011.
GRAND-HAURY
Si l’on exclut La Cascina, cet ancien édifice agricole dépendant du château de Montmayeur, la chapelle dédiée à Sainte-Marie-Madeleine est le premier bâtiment que l’on rencontre en arrivant au Grand-Haury. Elle est citée pour la première fois dans un acte notarié de 1362, mais l’édifice actuel semble remonter à 1473.
Une légende transmise par les vieux du village raconte qu’il y a plusieurs siècles, la chapelle abritait deux anciennes statues représentant saint Hilaire et sainte Barbe. Elles étaient en si mauvais état que les habitants du village les avaient déplacées à l’extérieur de l’édifice, sans se soucier de leur sort, dans l’intention de les remplacer par de nouvelles statues. Des enfants les prirent pour jouer et les traînèrent dans la boue avec des cordes. Immédiatement, il commença à pleuvoir, très fort, comme jamais auparavant : les gens entendirent aussi des bruits sourds inexplicables. Quand les eaux du torrent débordèrent, ils s’aperçurent de leur imprudence : ils prirent les statues et les lavèrent pour les remettre à leur place. Il plut encore jusqu’au lever du soleil, puis la pluie cessa soudainement et les habitants décidèrent alors d’aller voir ce qui avait pu provoquer les bruits sourds qu’ils avaient entendus. En amont du village, dans la forêt, ils virent, sur la paroi rocheuse, de grosses fissures qui n’existaient pas auparavant et que l’on peut encore voir aujourd’hui : le village avait risqué d’être emporté par des éboulements.
Le Grand-Haury est caractérisé par sa position le long d’un axe, qui va de la chapelle au moulin, passant à côté du four récemment rénové, dont la salle est aussi utilisée pour des moments conviviaux.
Les maisons du hameau ont presque toutes été rénovées avec soin et bon goût. Certaines d’entre elles accueillent désormais des activités touristiques, qui attirent des touristes où, en été, s’installent aussi de nombreuses familles de la commune.
Avant d’arriver au village, au-dessous de la route communale, l’on trouve la scierie à eau de la famille Pontal, alors qu’aux alentours du hameau, sur un éperon rocheux, l’on peut admirer l’ancien château de Montmayeur, qui ressemble à une enceinte fortifiée plutôt qu’à un château résidentiel.
Ce dernier fut fondé en 1271, lorsque Philippe de Savoie donna à Anselme et Aymon d’Avise la permission de le construire. Cette date a récemment été confirmée par les résultats des relevés dendrométriques effectués sur des échantillons de bois prélevés dans le donjon et sur les remparts.
La tour présente un couronnement crénelé en queue d’aronde et mesure environ douze mètres de haut, avec des murs dont l’épaisseur dépasse les deux mètres : sa porte d’entrée se trouve au niveau du premier étage.
Le château qui, par sa position géographique, est l’un des plus charmants de la Vallée d’Aoste, fut cédé aux Savoie au XIVe siècle, puis inféodé aux Avise, avant d’être progressivement abandonné. Il appartient aujourd’hui à un particulier.
Des gens s’aventurent parfois dans ses environs, pour chercher l’ancien trésor qui, selon la légende, fut caché par le seigneur de Montmayeur.
Sources :
Ambroise Roux, La Paroisse d’Arvier, Imprimerie Catholique, Aoste 1910
Pro Loco d’Arvier, Le Conte d’eun cou, Imprimerie valdôtaine, Aoste 1995
Ezio Gerbore et al., Arvier, Una comunità nella Storia, Musumeci editore, Quart 2004
G. GLAREY et al., Planaval, Histoire, mémoire et traditions d’une petite communauté, Le Château, Aoste 2009
Nella Chabod et al., Baise-Pierre : entre histoire et souvenir, Tipografia Marcoz, Morgex 2011.
Oggi (giovedì 7 aprile 2022) la Giunta Regionale ha individuato "AGILE ARVIER" quale progetto pilota della Valle d'Aosta per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi, da trasmettere al Ministero della Cultura nell’ambito dell’intervento “Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Attrattività dei Borghi, Linea A”, che dovrà validarlo al fine dell'erogazione dei fondi.
Una sintesi del progetto è consultabile sul sito https://agilearvier.eu dove è inoltre possibile scaricarne una copia in PDF.
L'Amministrazione comunale organizzerà degli incontri per illustrare il progetto alla popolazione e per definire in maniera più dettagliata gli interventi individuati.

SCAFFALE 26
Negli ultimi tempi i canali di comunicazione digitale hanno permesso di ridurre le distanze tra le persone, di collegare e avvicinarle.
In questo spirito la Biblioteca del Comune di Arvier ha ideato la campagna "SCAFFALE26":
Così come la statale 26 é la via che unisce tutti gli abitanti della valle, allo stesso modo il nostro Scaffale si propone di unire culturalmente gli orizzonti dei nostri lettori.
Speriamo che il nostro #Scaffale26, sebbene virtuale, possa simboleggiare un immagine concreta, un luogo, una mensola dove poter consultare e riporre le nostre e vostre proposte letterarie!
Tutti i martedì, sulla pagina facebook della biblioteca, vi proporremo esperienze ed emozioni con un nuovo libro da leggere: perché leggere é viaggiare stando seduti!